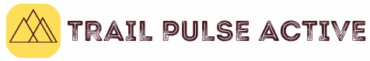🏔️ Le fractionné long, un allié méconnu des traileurs
Quand on pense au trail, on imagine d’abord les montées raides, les descentes techniques, l’endurance mentale… mais rarement le travail de vitesse. Pourtant, intégrer du fractionné long dans sa préparation est un levier redoutable pour progresser, même (et surtout) en montagne.

Souvent associé à la course sur route ou à la piste, le travail de vitesse semble à première vue éloigné des exigences du trail. Et pourtant, de nombreux athlètes élites – y compris en ultra-trail – intègrent des séances spécifiques de fractionné long dans leur plan d’entraînement. Ce n’est pas un hasard : ce type de travail permet de développer l’endurance à haute intensité, d’améliorer la capacité de relance et de mieux gérer les efforts prolongés en terrain vallonné.
📊 Une étude menée en 2021 sur des traileurs amateurs a montré qu’un cycle de 6 semaines incluant deux séances hebdomadaires de fractionné long a permis une amélioration de 8 à 12 % du VO2 max (consommation maximale d’oxygène) et une réduction du temps d’effort sur un trail de 25 km de 6 % en moyenne.
Loin d’être réservé aux coureurs sur bitume, le fractionné long devient donc un outil stratégique pour les traileurs souhaitant franchir un cap.
I. Qu’est-ce que le fractionné long en trail ?
A. Définition
Le fractionné long désigne des séances composées d’efforts prolongés (généralement entre 4 et 12 minutes) à une intensité située entre 80 % et 90 % de la FC max (fréquence cardiaque maximale), souvent proche de l’allure seuil. Contrairement aux sprints ou aux répétitions très courtes, l’objectif ici est de tenir un rythme soutenu sur une durée significative, tout en maintenant une bonne qualité de foulée et de respiration.
Quelques exemples typiques de séances :
- 4 x 6 minutes avec 2 à 3 minutes de récupération active entre les répétitions
- 3 x 10 minutes à allure seuil (autour de l’allure 10 km), sur terrain vallonné
- 2 x 12 minutes en côte modérée avec récupération en descente
Ces séances visent à améliorer l’endurance à intensité élevée, retarder l’apparition de la fatigue et habituer le corps à maintenir un effort constant, malgré le terrain changeant du trail.
B. Différence avec le fractionné court
Le fractionné court, comme les séries de 30/30, 45/15 ou les répétitions courues à VMA (Vitesse Maximale Aérobie), vise principalement à développer l’explosivité, la puissance cardiovasculaire et la vitesse maximale aérobie.
La VMA correspond à la vitesse la plus élevée qu’un coureur peut maintenir tout en utilisant 100 % de sa capacité d’oxygène (VO₂ max) — généralement sur une durée de 4 à 8 minutes selon le niveau. Travailler à cette intensité permet de repousser ses limites en termes de vitesse et de capacité à encaisser des efforts très courts mais très intenses.
En opposition, le fractionné long s’inscrit dans une zone d’effort intermédiaire, entre l’endurance fondamentale et l’intensité maximale. Il ne cherche pas la vitesse brute, mais la capacité à soutenir un rythme soutenu dans la durée, un atout fondamental sur les parcours exigeants et prolongés typiques du trail.
C. Spécificité trail
En trail, le fractionné long prend une dimension particulière. Il ne s’agit pas seulement de courir vite, mais de gérer intelligemment l’intensité dans un environnement irrégulier :
- Travail en côte : faire des répétitions sur une montée régulière permet de solliciter les groupes musculaires spécifiques du trail (ischio-jambiers, fessiers, mollets) tout en travaillant le souffle.
- Variations de terrain : chemins caillouteux, monotraces, racines ou dévers rendent l’effort plus technique et sollicitent aussi la proprioception et l’agilité.
- Allure “au ressenti” : sur les pentes raides ou les descentes techniques, les allures de route ne sont plus des repères fiables. Le traileur apprend à se fier à ses sensations, à son souffle et à sa fréquence cardiaque pour doser l’effort en fonction du dénivelé positif (D⁺) ou des conditions du jour (météo, fatigue, altitude).
II. Pourquoi intégrer du fractionné long en trail ?
A. Amélioration de l’endurance à haute intensité
L’un des défis majeurs en trail, notamment sur les formats longs, est de maintenir un effort soutenu sur la durée sans s’épuiser prématurément. Le fractionné long pousse l’organisme à rester efficace dans une zone d’intensité élevée, ce qui développe une capacité à “tenir” l’allure même dans les moments exigeants, comme en fin de course ou sur des segments clés. En travaillant cette endurance spécifique, le traileur gagne en constance et en efficacité énergétique.
B. Optimisation de la filière aérobie (seuil anaérobie)
Travailler autour du seuil anaérobie permet de repousser la zone où le corps commence à accumuler de l’acide lactique de manière significative. Grâce au fractionné long, cette zone tampon s’élargit : on peut courir plus vite sans basculer dans l’essoufflement excessif ou l’inconfort musculaire. Cela se traduit concrètement par une meilleure capacité à encaisser les variations d’allure et à maintenir un effort stable dans les moments clés de la course.
C. Meilleure gestion des efforts prolongés (montées, relances)
Le trail exige une adaptation permanente à l’effort, notamment dans les longues montées, où l’intensité grimpe naturellement, et lors des relances après des descentes ou des passages techniques. Le fractionné long renforce cette résilience musculaire et mentale, en habituant le corps à rester actif sous tension prolongée. Il développe aussi une meilleure perception de l’effort, essentielle pour éviter les coups de mou ou les départs trop rapides.
D. Simulation d’efforts de course (ultras, longues ascensions)
Enfin, ces séances peuvent servir de répétitions générales pour les compétitions : en choisissant des parcours vallonnés ou des côtes similaires à celles rencontrées en course, le fractionné long devient une forme d’entraînement spécifique, proche des conditions réelles. Cela permet non seulement de tester son matériel et sa nutrition, mais aussi d’évaluer ses sensations à des allures de course. Une approche précieuse pour ceux qui se préparent à des formats longs ou ultras, où la capacité à enchaîner des efforts soutenus est souvent déterminante.

III. Comment structurer une séance de fractionné long trail
Le fractionné long demande un engagement physique et une concentration soutenue. Pour en tirer tous les bénéfices tout en limitant les risques de blessure ou de surmenage, il est essentiel de construire la séance de manière cohérente. Voici les trois phases clés.
A. Échauffement : préparer le corps et l’esprit
Un bon échauffement ne se limite pas à quelques minutes de course lente. En trail, il s’agit aussi de préparer le corps à l’intensité progressive sur terrain irrégulier. Prévoyez 15 à 20 minutes de footing souple, de préférence sur sentier, pour activer la circulation sanguine et faire monter la température corporelle.
Ajoutez ensuite :
- 2 à 3 montées progressives (entre 30 secondes et 1 minute), en augmentant l’intensité à chaque répétition
- Quelques mouvements dynamiques (foulées bondissantes, talons-fesses, montées de genoux) pour réveiller la chaîne postérieure et la coordination
L’échauffement est aussi un moment pour se connecter mentalement à la séance : repérer les segments choisis, anticiper les temps d’effort, et adapter sa concentration.
B. Bloc principal : variété et spécificité
Le cœur de la séance peut varier en fonction de l’objectif (travail en côte, endurance seuil, gestion d’effort mixte). L’important est de maintenir un niveau d’intensité stable mais exigeant, où l’effort reste contrôlé mais sollicite pleinement l’organisme.
Voici quelques formats concrets, adaptés au trail :
- 🟢 3 x 8 minutes à allure seuil, avec 2 minutes de récupération trottée entre chaque bloc : idéal pour travailler la régularité et le souffle sur terrain mixte.
- 🔵 2 x 10 minutes en côte douce, suivies de 6 minutes sur terrain plat : cette combinaison développe la force spécifique et la capacité de relance après un effort soutenu en montée.
- 🟠 4 x 6 minutes sur sentier technique, avec 1’30 de récupération active : utile pour s’adapter aux changements de rythme imposés par les irrégularités du terrain.
Pense à ajuster la durée ou l’intensité selon ton cycle d’entraînement, ton état de forme et le profil de ta prochaine course.
C. Retour au calme : faire redescendre la machine
Le retour au calme est souvent négligé, mais il joue un rôle clé dans la récupération et la prévention des blessures. Il permet de réduire progressivement la fréquence cardiaque et de faciliter l’élimination des déchets métaboliques.
- Termine la séance par 10 minutes de course lente, sur terrain souple si possible
- Ajoute quelques étirements légers (mollets, quadriceps, fessiers, bas du dos) sans forcer, pour détendre les muscles sollicités
Ce moment de transition est aussi l’occasion de faire le point sur tes sensations, et de noter ce que tu pourrais ajuster pour les prochaines séances.
IV. Où et quand le placer dans sa planification ?
Le fractionné long est un outil puissant… à condition de l’utiliser au bon moment et dans le bon contexte. Mal placé, il peut devenir contre-productif. Voici comment l’intégrer intelligemment dans ta planification.
A. Période idéale : préparation spécifique ou cycle de développement aérobie
Le fractionné long trouve toute sa pertinence dans deux phases clés de l’entraînement :
- En préparation spécifique, à 6 à 8 semaines d’un objectif, il permet d’affiner l’allure de course, d’habituer le corps aux contraintes de l’effort soutenu et de recréer des conditions proches de celles de la compétition.
- En cycle de développement aérobie, en dehors de la période compétitive, il contribue à bâtir une base solide, en renforçant le cœur, la respiration et la capacité à maintenir une intensité prolongée.
Il n’est en revanche pas recommandé en période de régénération ou en tout début de reprise, où l’organisme n’est pas encore prêt à encaisser ce type d’effort.
B. Une fois par semaine maximum
Même si ses bénéfices sont nombreux, le fractionné long reste une séance exigeante pour le système nerveux, musculaire et cardiovasculaire. Il est donc conseillé de ne pas dépasser une séance par semaine, surtout si elle est intégrée à une routine incluant d’autres sollicitations (sortie longue, travail en côte, VMA…).
Chez les coureurs expérimentés, une alternance hebdomadaire avec d’autres types de séances qualitatives (ex. VMA un mardi, fractionné long la semaine suivante) peut offrir un bon équilibre.
C. À placer loin d’une sortie longue ou d’une séance VMA
Pour éviter le cumul de fatigue et maximiser la récupération, il est crucial de bien espacer les séances intensives. Le fractionné long ne doit jamais être enchaîné avec :
- une sortie longue (idéalement espacée d’au moins 48 heures)
- une séance de VMA ou de côte explosive, qui sollicite également le système aérobie de manière intense
Une bonne pratique consiste à le programmer :
- en milieu de semaine si la sortie longue est prévue le week-end
- ou en début de semaine, après une journée de repos ou de footing léger
L’écoute du corps et l’adaptation au ressenti restent des principes fondamentaux pour tirer le meilleur de ce type de séance sans risque de surmenage.
V. Conseils pour bien exécuter le fractionné long
Réussir une séance de fractionné long ne dépend pas uniquement de la durée des blocs ou de la pente choisie. La qualité d’exécution fait toute la différence. Voici quelques repères pour maximiser les bénéfices sans gaspiller d’énergie inutilement.
A. Utiliser la fréquence cardiaque ou l’allure au seuil
Pour calibrer l’intensité, les outils de mesure comme la fréquence cardiaque ou l’allure de seuil sont des alliés précieux. En règle générale, les blocs de fractionné long se situent autour de 85-90 % de la FC max ou à l’allure que l’on peut tenir sur environ une course d’une heure.
- Si tu t’entraînes avec une montre cardio, garde un œil sur ta zone cible.
- Si tu préfères les allures, base-toi sur des tests récents ou une séance de référence (ex : temps sur 10 km ou test de seuil ventilatoire).
B. Privilégier le ressenti sur terrain irrégulier
En trail, les données numériques deviennent vite approximatives. Pentes, dévers, appuis instables : les allures varient naturellement. Dans ces cas-là, l’effort perçu devient le meilleur indicateur.
Un bon repère :
Tu dois pouvoir parler par courtes phrases, mais pas chanter. Tu es à la limite du confort, sans jamais “exploser”.
C. Choisir un terrain proche de la course cible
Le fractionné long est aussi une opportunité de travailler en conditions spécifiques. Autant que possible, choisis un terrain qui ressemble à celui de ton objectif :
- Pour un trail de montagne : longues côtes régulières ou chemins forestiers en montée
- Pour un trail roulant : sentiers mixtes, légères montées / descentes
- Pour un ultra : alterne terrain technique et portions de relance
L’objectif est de conditionner ton corps, mais aussi ton mental, à l’environnement que tu retrouveras en course.
D. Bien récupérer entre les blocs (qualité > quantité)
Trop souvent, les coureurs raccourcissent la récupération pour “gagner du temps”. Mauvaise idée. Une récupération bien gérée (souvent 2 à 3 minutes de trot léger) permet de maintenir une exécution propre sur chaque bloc.
👉 Mieux vaut faire 3 répétitions bien réalisées que 5 bâclées en fin de séance.
👉 L’objectif n’est pas de “se finir”, mais de stimuler efficacement les bonnes filières
VI. Erreurs fréquentes à éviter
Même bien intentionné, un fractionné long mal exécuté peut rapidement perdre en efficacité, voire conduire à la blessure ou au surmenage. Voici les erreurs les plus courantes que commettent de nombreux traileurs, et comment les éviter.
1. Aller trop vite : confondre seuil et VMA
C’est l’erreur la plus classique : partir sur les blocs avec une intensité trop élevée, proche de la VMA, pensant que « plus vite = mieux ». En réalité, cela dénature totalement l’objectif de la séance, qui repose sur un effort soutenu mais contrôlé.
➡️ Le bon repère : tu dois pouvoir tenir chaque intervalle sans exploser, en gardant une foulée propre et régulière du début à la fin.
2. Négliger l’échauffement
Un fractionné long effectué sans préparation adéquate, c’est comme attaquer une montée raide à froid : risque de blessure, mauvaise sensation dès le départ, et rendement réduit.
➡️ Accorde 15 à 20 minutes à un échauffement structuré (footing + activations) pour mettre le corps en condition, et pour aborder le cœur de la séance avec fluidité.
3. Ne pas adapter le terrain
Réaliser ton fractionné long sur un bitume plat alors que tu prépares un trail alpin… c’est passer à côté de l’intérêt spécifique de la séance. À l’inverse, un terrain trop technique peut nuire à la qualité de l’effort ciblé.
➡️ Choisis un terrain représentatif de ta course : pente régulière, sentier roulant, mixte… L’objectif est de solliciter les bons muscles, la bonne foulée, et les bons repères d’effort.
4. Trop charger la semaine d’entraînement
Le fractionné long, bien que moins intense que du travail VMA, reste une séance exigeante sur le plan physiologique. L’enchaîner avec une sortie longue, une séance de côtes explosives ou une grosse charge volume dans la même semaine fragilise l’équilibre général de ton plan.
➡️ Pense récupération et progressivité : une bonne répartition des charges est la clé pour progresser durablement sans casse physique ni mentale.
VII. Exemples de séances selon le niveau
Le fractionné long peut (et doit) être adapté au niveau d’expérience, de forme et d’objectif de chaque traileur. Inutile de viser trop haut trop tôt : une séance bien calibrée apportera bien plus de bénéfices qu’une tentative trop ambitieuse mal exécutée. Voici trois formats-types, progressifs et faciles à mettre en œuvre.
🟢 Débutant : 2 x 6 min en montée douce
Objectif : s’habituer à maintenir un effort soutenu en côte, sans dépasser le seuil.
- Terrain : montée régulière, 4 à 6 %
- Récupération : 3 minutes de marche ou trot en descente
- Conseil : rester en aisance respiratoire ; terminer chaque bloc avec une sensation de “bon effort”, mais sans être à bout.
🔵 Intermédiaire : 3 x 8 min sur terrain mixte
Objectif : développer l’endurance à haute intensité et la capacité à relancer.
- Terrain : alternance de faux plats, petites côtes et sections roulantes
- Récupération : 2 minutes de footing léger
- Conseil : maintenir une foulée active, fluide, et rester concentré sur la posture malgré la durée de l’effort.
🔴 Avancé : 2 x 10 min en montée + 6 min sur plat
Objectif : simuler une phase de course intense, avec relance après une ascension.
- Terrain : montée soutenue (6 à 8 %) suivie d’un sentier roulant
- Récupération : 3 minutes de footing très lent ou marche active
- Conseil : gérer le premier bloc avec retenue pour pouvoir finir fort sur le plat — excellent test pour les ultras.
Un levier de progression trop souvent sous-estimé
Le fractionné long est bien plus qu’un simple exercice d’intensité : c’est un outil stratégique pour développer l’endurance, l’efficacité et la résistance mentale sur les sentiers. En travaillant à des intensités proches du seuil, il prépare le corps à encaisser les efforts prolongés, fréquents en trail, tout en renforçant la capacité à gérer les variations de rythme et à relancer dans les moments clés.
Accessible à tous les niveaux, à condition d’être bien dosé et intégré avec intelligence dans une planification équilibrée, il représente un levier de progression incontournable pour qui souhaite sortir de sa zone de confort et élever son niveau.
Adopté avec régularité, il ne tarde pas à porter ses fruits — sur les montées comme sur les lignes d’arrivée. 💥🏔️